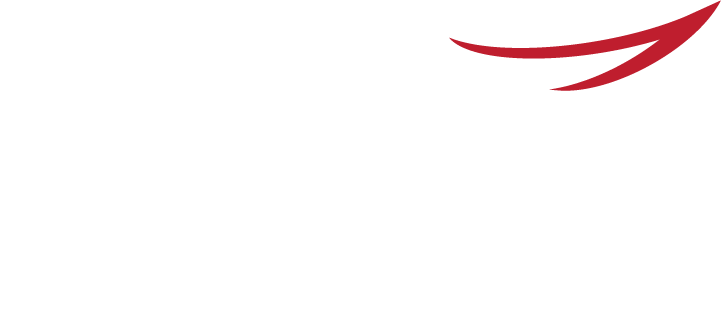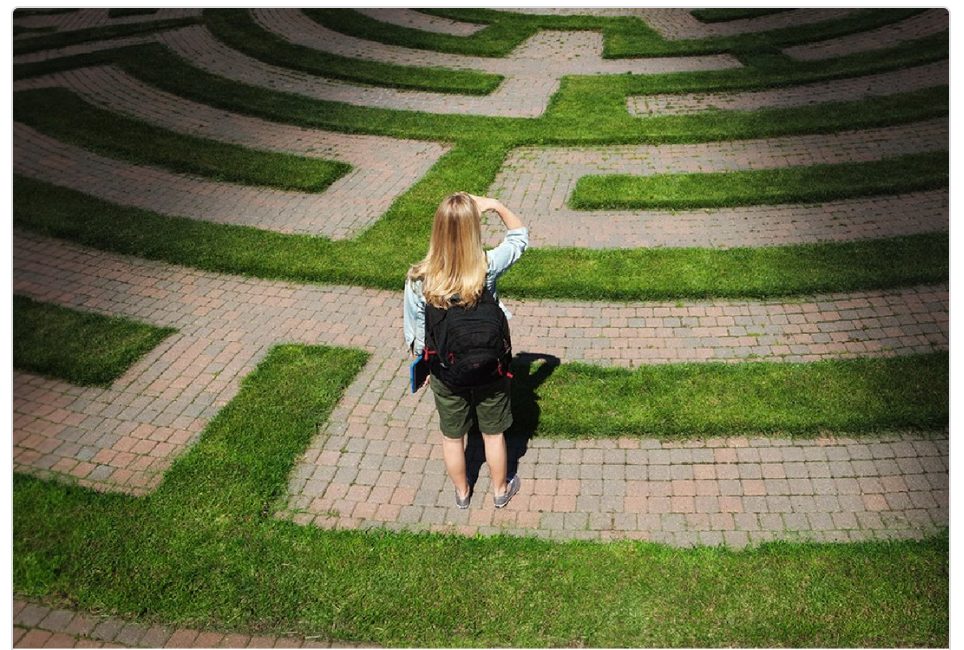
Que les consultants en stratégie soit l’un des principaux viviers des cabinets ministériels n’est pas un secret. Mais quelles sont les différences et similitudes fondamentales de ces deux métiers en matière d’approche, d’analyse, de livrables et au-delà de compétences ?
Les différences entre le Consultant en Stratégie et le Conseiller Ministériel sont notables pour Hélène De Vestele qui a vécu une expérience singulière en devenant conseillère du ministre argentin de la Modernisation et du Développement durable, Andrés Ibarra, de 2015 à 2017. Elle a rejoint une filiale du groupe Kéa qui intervient auprès des DG et d’autres directions en matière de formation, transition écologique et impact – après avoir évolué notamment dans le conseil interne, chez Safran, où elle était en charge des données biométriques.
L’autre est devenu conseiller ministériel récemment au sein des ministères sociaux. Il avait passé un peu plus de 2 ans chez l’un des leaders du conseil en stratégie en France. Ce conseiller a choisi de s’exprimer sous couvert d’anonymat.
L’aide à la décision : scission non binaire entre les deux métiers
Pour bien faire son travail, un conseiller doit prendre en compte l’ensemble de l’écosystème, toutes les parties prenantes et bien sur leurs intérêts, lesquels ne sont pas toujours chiffrés en euros, indique notre témoin ministériel rencontré à Bercy et qui souhaite rester anonyme.
Quant au consultant, il émet des recommandations à destination d’un client, en général une entreprise tenue à la performance et à la rentabilité. Si, au premier abord, les KPIs du conseil peuvent sembler plus basiques que ceux d’un cabinet ministériel, ils sont en réalité multiples et croisés dans les deux cas.
Quels biens et services cherche-t-on à délivrer et comment priorise-t-on ou hiérarchise-t-on les différents objectifs ? C’est une question essentielle que l’on se pose. L’enjeu commun étant de faire apparaître quelles sont les valeurs à produire et les problèmes à éviter (voir l’analyse SWOT), tout en élaborant le bon raisonnement et en définissant les différentes étapes pour accompagner la prise de décision.
Ainsi nous pouvons avancer que l’aide à la décision intervient selon les mêmes principes. Les deux métiers visent à l’amélioration d’une situation donnée et l’intérêt général : dans le cadre de l’entreprise dans un cas ou d’un gouvernement dans l’autre cas. En partant de l’existant et en tenant compte de certaines contraintes. »
La pression : plus forte chez le conseiller ministériel
Les différences entre le Consultant en Stratégie et le Conseiller Ministériel viennent des préconisations. Argumentées à ses clients pour le Consultant en Stratégie pour l’un alors que l’autre produit des notes de synthèse visant à opérer des arbitrages. Pour les deux exercices, l’attendu du donneur d’ordre est un executive summary ou nous pourrions dire aussi un plan opérationnel. Mais le conseiller ministériel est soumis de façon beaucoup plus forte à la pression des parties prenantes, explique le conseiller anonyme. Dans l’arbitrage, il faut y voir clair, s’assurer de poursuivre le bon objectif pour pouvoir ajuster les moyens à ce dernier. Les enjeux deviennent politiques, économiques mais aussi le cadre de l’action plus restreint ou parfois plus long. Le temps d’une mandature, le temps de se concerter avec les partenaires sociaux, le temps de faire redescendre un climat ou une « affaire »…
Quant aux sources de satisfaction, elles sont assez peu éloignées.
1 point partout, la balle au centre
« Très clair » ou « je te call asap », dans le monde du conseil. « Bien pris » dans celui des cabinets ministériels et de l’administration, pour dire « bien reçu », ou « il faut traiter cette personne » – parce qu’elle est importante dans l’écosystème et qu’il faut « lui témoigner de la considération », même si l’on ne prendra pas nécessairement en compte ce qu’elle dit. Chaque monde dispose donc de son propre jargon. Et je dois dire que pour le cabinet en stratégie que je dirige nous ne sommes pas fan de ces Anglicismes qui ont peu d’intérêt dans la compréhension des clients, rendent parfois le consultant pompeux et surtout ne sont pas toujours maitrisés dans leur sens par les clients (…)
Les anglicismes arrivent également dans la fonction publique, « alors même que les humoristes s’en moquent à juste titre », ironise Hélène De Vestele. Le conseil en stratégie a « plus d’influence qu’on ne pourrait l’imaginer ».
Plus sérieusement, il est « assez modélisant via ses outils conceptuels et méthodes – le fait de travailler à partir d’hypothèses, etc. », indique l’ancien consultant, tout en reconnaissant avoir un regard « un peu biaisé ».
Le protocole, en revanche, joue un rôle beaucoup plus important dans les cabinets ministériels et le monde administratif plus largement. « Les gens connaissent parfaitement les institutions ainsi que leurs oppositions “historiques” sur tel ou tel sujet. » Dès lors, les références revêtent davantage d’importance. « Il faut aller parler à la SD5 [sous-direction 5] de la DGCS [Direction générale de la Cohésion sociale] – tout le monde sachant parfaitement de quoi il s’agit. Il est indispensable de s’approprier les organigrammes et les titres. »
Un protocole dont l’un des objectifs serait, selon Hélène De Vestele, « de créer une distance, voire un mythe de supériorité ». Lorsqu’elle faisait partie du cabinet du ministre argentin Andrés Ibarra, « tout le monde s’affairait [autour d’elle] et des autres membres du gouvernement, nous étions conviés à de grands dîners, alors que nous occupions une fonction donnée, comme d’autres en occupent une autre ».
La liberté de parole et l’influence : net avantage au consultant en Stratégie
Dans les différences entre le Consultant en Stratégie et le Conseiller Ministériel dans le conseil, on attend du consultant qu’il donne son avis, bien qu’il doive en parallèle « gérer la relation commerciale », indique le conseiller souhaitant rester discret. Le point d’attention tient dans le décalage éventuel « entre l’intérêt commercial du cabinet, la déontologie du consultant et sa conviction sur un sujet donné ». Pour Hélène De Vestele, « une certaine créativité » fait partie du job de consultant en strat’.
De son côté, le conseiller ministériel se met au service du ministre ou, plus exactement, de son projet. « Il est recruté par une personne, dans le cadre d’un mandat donné. Si le ministre tombe, le conseiller ministériel aussi. Le conseiller entre sans doute plus facilement dans un effet de cour. » Et les marges de manœuvre sont plus ténues pour « dire au ministre qu’il se trompe ou pour plaider en faveur d’une direction » n’ayant pas été envisagée.
Ce que corrobore Hélène De Vestele. « Très souvent, le conseiller ministériel se heurte à l’impossibilité, pour le ministre avec lequel il travaille, de faire les choix politiques nécessaires. Des logiques “politiciennes” s’imposent, alors qu’elles sont en contradiction avec la recherche du bien commun. La politique interne joue un rôle dans toute décision, quelle que soit sa nature. »
Pour faire avancer ce qui lui tient à cœur, le conseiller va devoir construire « de la conviction, du projet, des coalitions, des alignements d’intérêt » aboutissant à l’absorption des « résistances au profit de l’élan », explique notre témoin ministériel anonyme.
L’ego : plus prégnant encore dans les arcanes du pouvoir politique
Les cabinets ministériels sont en proie à davantage d’incertitude. Chacun doit se montrer très vigilant « quant à ses prérogatives et à son périmètre de responsabilités », décrypte-t-il encore. Dans cette optique, les questions d’ego peuvent sembler plus marquées.
Le « prestige » associé à tout ce qui touche aux fonctions ministérielles intervient sans doute également. « Quand on représente un ministère, on est mis sur un piédestal, témoigne Hélène De Vestele, là où le consultant, qui reste davantage dans l’ombre, peut conserver une plus grande humilité. » Ce n’est pas toujours ce qui ressort quand on évoque les consultants des MBB notamment…
Quoi qu’il en soit, au sein des cabinets de conseil, « bien qu’il y ait des jeux d’influence, surtout à moyen terme, les enjeux de pouvoir sont sans doute davantage régulés. Or, les questions d’ego en découlent », estime l’ancien consultant. Hélène De Vestele plussoie. « Le conseil en stratégie me semble avant tout méritocratique dans la valorisation des capacités et rendus professionnels d’une personne. »
L’allocation de ressources : un gros avantage au conseil en stratégie
Le dimensionnement de l’action se fait de façon bien distincte dans ces deux métiers. Un consultant peut se permettre de résoudre « 80 % des cas simples, sans se soucier des 20 % de cas complexes ». Or, selon notre témoin ministériel, « un acteur public est obligé de répondre également aux cas complexes et, donc, de se montrer non éfficient. » Sachant que les moyens sont beaucoup plus contraints dans le secteur public « à ce moment-ci de l’histoire », et que les décisions y relèvent davantage « de la “politique”, ce qui conduit à saupoudrer et à donner des coups de rabot homogènes quand il faut couper la dépense ».
Dans le cadre de l’action publique, on en arrive donc à allouer les moyens « de façon non éfficiente, en le sachant, en raison de pressions politiques ou de réticences au changement ».
Les compétences : toujours discutable mais transposables d’un métier à l’autre
Dans les différences entre le Consultant en Stratégie et le Conseiller Ministériel une nuance néanmoins : les clés d’entrée des problématiques ne sont pas les mêmes pour des profils issus du conseil ou de la haute administration. « La grille de lecture d’un ancien consultant et sa façon de poser des hypothèses ou de quantifier, de remonter à la donnée » sont utiles, mais doivent s’articuler avec celles de personnes raisonnant en termes « de cadre administratif et de principes, ou en fonction du droit et d’un projet politique ».
De son côté, Hélène De Vestele souligne « l’origine commune de tous ces profils, issus des mêmes grandes écoles, avec des méthodes de travail qui se rejoignent. Ces deux métiers nécessitent de la rigueur et mobilisent une stratégie de l’écrit, pour que le processus d’étude et de décision soit le plus rationnel possible ».
Une différence notable en revanche tient dans l’approche systémique des problématiques, usuelle dans le conseil en stratégie là où les gouvernements « doivent tenir compte des prérogatives des différents ministères, ce qui peut considérablement ralentir les projets ». De plus nous ne pouvons pas ignorer des contingences parfois très politiques qui peuvent engager des décisions plus ou moins adaptées voire étonnantes parfois (…)